Aujourd’hui j’ai chance d’accueillir sur le site une personne dont j’admire beaucoup le travail en France : Rozenn Colleter ! Avec Rozenn nous avons eu l’occasion de nous rencontrer rapidement en chair et en os au SAO de Rennes en 2020, les colloques et rencontres sont des moments privilégiés pour rencontrer des chercheurs de diverses disciplines regroupés autour d’un sujet donné. Et pour moi, c’est toujours une très grande source d’enrichissement personnel !
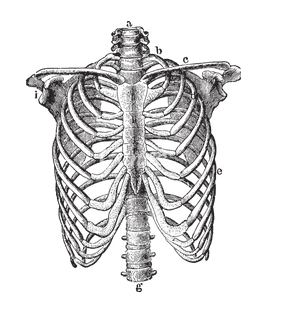
Bonjour Rozenn, merci beaucoup d’accepter cette interview, c’est un honneur que de vous recevoir. Première question très classique mais un peu obligatoire, pouvez-vous vous présenter au lectorat et nous parler de votre parcours ?
Bonjour Juliette, merci pour cet entretien. Je suis aussi très contente de faire partie des « portraits » du Bizarreum. Quel honneur et bravo pour votre travail de recherche sur la thanatologie et sa vulgarisation pas toujours facile ! ☺
Je suis archéo-anthropologue à l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) c’est-à-dire que je suis à la fois, archéologue et anthropologue. Sur les terrains archéologiques, je fouille des squelettes humains, je note, dessine et photographie les restes humains puis je prélève les ossements pour les étudier plus finement en laboratoire. C’est un vrai travail d’équipe qui permet de préserver les archives matérielles de notre passé par l’enregistrement des données. Je travaille la plupart du temps dans des contextes d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant des travaux d’aménagement du territoire. Ensuite, en laboratoire, les squelettes sont lavés, reconstitués s’il le faut et inventoriés. Grâce aux méthodes empruntées au départ à la médecine légale puis complétées par des anthropobiologistes, nous reconstituons de véritable fiche d’identité archéologique pour chaque squelette en déterminant son âge au décès, son sexe, sa stature, ses maladies, son alimentation et même sa datation (par radiocarbone par exemple) ou son ADN (si les financements nous le permettent !). Nous créons ainsi des « collections ostéologiques » qui seront versées à l’État et, en général, conservées pour pouvoir éventuellement être réétudiées (nouvelle problématique ou type d’analyses, formation d’étudiants…). À l’issue de chaque fouille ou diagnostic archéologique, un rapport est également remis avec l’ensemble des données. Ce sont les Services régionaux d’archéologie, dépendant du Ministère de la Culture, qui autorisent les fouilles. Les informations sont enfin publiées dans des revues scientifiques validées par nos pairs, mais aussi vulgarisées auprès d’un public plus large (scolaire, étudiant, grand public). Toute cette chaîne opératoire fait partie des missions de l’Inrap. C’est un métier très polyvalent, collectif où on ne cesse d’apprendre et de découvrir des choses !
C’est peut-être pourquoi j’ai une formation assez éclectique et qui s’est prolongée sur plus de 20 ans ! Si j’ai toujours voulu être archéologue, je ne savais pas bien comment y arriver dans les années 1990… J’ai donc d’abord obtenu un DEUG d’Histoire à l’Université de Rennes 2, puis une Licence et une Maîtrise d’Archéologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Mon sujet à l’époque portait déjà sur les cimetières mérovingiens de Mayenne… Parallèlement, j’ai eu le plaisir d’être recrutée en 1999 comme technicienne de fouille à l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques nationales) puis à l’Inrap. En 2005-2006, je me suis inscrite à l’Université Paul Sabatier de Toulouse III pour suivre un Master 2 Recherche en Anthropobiologie et c’est à la même université que j’ai obtenu mon doctorat en 2018 sous la tutelle du laboratoire AMIS (UMR 5288 du CNRS, Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse, devenu Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse en 2021). Dernièrement, j’ai obtenu une bourse européenne Marie Skłodowská Curie pour effectuer un post-doctorat de deux années portant sur les inégalités sociales discernables à partir d’isotopes stables conservés dans les squelettes humains. Je vais donc me former à de nouvelles recherches en partenariat avec l’université Simon Fraser de Vancouver (Canada), le laboratoire Géosciences Environnement de Toulouse (CNRS-UMR 5563) et l’Inrap.

© Stéphane Blanchet
Ces dernières années, c’est avec grand plaisir que nous avons pu vous voir régulièrement dans l’actualité archéologique. Il est toujours bénéfique pour le public d’écouter les chercheurs, est-ce un exercice qui vous est familier ?
Je crois qu’on a tous plus ou moins peur de s’exprimer en public, de dire qu’on ne sait pas quoi répondre, voire de se ridiculiser. De plus, la communication est un exercice particulier pour lequel je n’ai pas été formée au cours de mon cursus universitaire. L’archéologie, notamment la fouille sur le terrain, attire vraiment le public et par conséquent de nombreux journalistes, mais les transcriptions de nos résultats peuvent parfois être décevantes ou voire erronées. Communiquer doit donc être une des finalités de nos recherches. J’ai eu la chance d’être approchée par une équipe de TEDx à Rennes en 2017 pour participer à leur évènement. J’ai d’abord refusé, mais ils sont revenus vers moi en 2018 dans la perspective d’une journée programmée au couvent des Jacobins de Rennes. Il s’agit d’un endroit particulier pour moi puisque j’y avais travaillé pendant près de deux ans avec une équipe de l’Inrap dirigé par Gaétan Le Cloirec. Cette proposition était d’abord pour moi une opportunité exceptionnelle de redécouvrir les lieux après les travaux d’aménagement du couvent. Même si je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais, la curiosité l’a emporté et j’ai signé ! Pour cet évènement, trois personnes (mes coaches !) m’ont aidé à formaliser le message que j’avais envie de faire passer au public. Cet entraînement m’a vraiment aidé à prendre la parole devant un auditoire impressionnant, qui comptait ce jour-là 1200 personnes dans l’amphithéâtre et 500 autres qui suivaient la retransmission dans une salle voisine.
Vous travaillez autour d’un sujet qui peut en faire frissonner plus d’un. Pourtant, vous savez choisir les bons mots et apporter de l’enthousiasme autour de vos travaux. Comment réagit le public la plupart du temps ?
Le public est toujours curieux de son passé. Les enfants posent souvent des questions encore plus percutantes que leurs ainés, sans doute parce qu’ils se sentent plus libres de les poser. J’essaie d’être honnête et de dire quand je ne sais pas ou quand je ne comprends pas bien la question. Quand le public visite des fouilles archéologiques où d’anciens restes humains sont dégagés, il n’est jamais indifférent. On projette sans doute sa propre image dans ces squelettes. Les trouve-t-on grands ? Petits ? Dans une position particulière ? Entourés ? Souriant de toutes leurs dents ? J’essaie d’écouter ces remarques, montrer que les pratiques funéraires, comme nos croyances, évoluent. Nous sommes tous différents, mais tous parents. Voir des squelettes, c’est une belle leçon d’humilité et d’humanité !
Dans vos travaux, vous avez une phase sur le terrain avec la fouille et bien-sûr tout l’après tant autour des restes humains que leur traitement, leur analyse et la restitution des informations. Pour donner une idée au lectorat, combien de temps peut prendre cet ensemble d’actions pour une session de fouille ?
La fouille des restes humains est fastidieuse (les positions de travail ne sont pas toujours simples), minutieuse et, par conséquent, assez longue. Pour fouiller un squelette, on prévoit en général une journée à laquelle une demi-journée supplémentaire est nécessaire pour enregistrer les informations et prélever les ossements. En amont de la découverte, il aura fallu enlever la terre végétale (le décapage dans notre jargon) afin de repérer la fosse sépulcrale, puis entamer sa fouille jusqu’à l’apparition du squelette. Après le terrain, il faut laver minutieusement les os pour faciliter les observations et l’on compte 3 à 4 squelettes par jour en fonction de leur état de conservation. En laboratoire, on élabore ensuite un « catalogue des tombes », sorte de compilation des informations sur chaque sépulture. Il faut alors compter une journée par sépulture pour son étude biologique et taphonomique (étude de l’ensemble des bouleversements qui ont eu lieu après la mise en terre et permettant de restituer la position originelle du défunt dans la tombe). Puis vient la phase rédactionnelle du rapport, avec la recherche des comparaisons, des statistiques, les plans et dessins, etc. Selon la conservation des vestiges et la période chronologique sur laquelle on travaille, cela peut prendre plus ou moins de temps auquel il faut toujours ajouter des aspects administratifs. Par exemple, pour un cimetière de 100 sujets, il faut compter en moyenne 150 jours de terrain et autant en laboratoire. Heureusement, les anthropologues ne travaillent pas seuls et c’est grâce à des équipes pluridisciplinaires que les délais sont respectés.

avec ma collègue Agnès Cheroux © Hervé Paitier
Le travail autour des restes humains est parfois mal vu de la part du public. Ces dernières années, de plus en plus de colloques ont lieu autour de l’éthique en archéologie et autour des dépouilles. Néanmoins, ces colloques sont souvent pointus. Pensez-vous qu’il y a un travail à faire pour le grand public en termes de transparence et de communication autour du traitement des corps ?
Il est vrai que ces questions ne sont sans doute pas assez débattues avec le public qui peut se sentir exclu. Cependant, il faut savoir que les os humains ne sont pas des vestiges archéologiques comme les autres. Ils n’ont pas le statut de mobilier archéologique, qui se caractérise par sa transformation par l’homme, par exemple la poterie ou les silex taillés. Ils répondent par ailleurs à des règles juridiques particulières sans pour autant qu’aucune loi sur l’archéologie ne les évoque spécifiquement. Les archéologues appliquent alors les lois bioéthiques de 1994 qui stipulent que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable et ses éléments ne peuvent faire l’objet de commerce lucratif ». Dans le cadre de l’archéologie préventive, nous enregistrons les archives du sol avant leur destruction. Fouiller et étudier ces archives est une mission de service public comme le rappelle l’article 16.1 du code du Patrimoine de 2004. L’archéologie est un bien commun et puisque l’archéologie, c’est l’étude de l’Homme, l’étude et la conservation des squelettes humains constituent une formidable source d’information pour témoigner et apprendre de ce passé.
Nous plaisantons souvent sur “l’absence” de restes osseux en Bretagne en archéologie (pour le public : taux pH-métriques du sol). Pourtant vous avez à votre actif de nombreuses fouilles et par conséquent fait connaissance avec beaucoup de dépouilles. Avez-vous toujours fouillé en Bretagne ou avez-vous eu des expériences ailleurs en France ou encore à l’étranger ?
La Bretagne est mon terrain d’étude et j’ai dû y côtoyer quelque 3 000 squelettes depuis 24 ans que je fouille. Toute une petite ville en somme ! Salariée de l’Inrap, je suis cependant mobile et j’ai donc également travaillé dans tout le Grand-Ouest de la France (Normandie et Pays de la Loire) mais aussi dans le Nord, dans le Périgord ou encore dans le Doubs. Je garde de ces excursions de fabuleux souvenirs et de belles rencontres même si, avec le temps et les contraintes familiales, c’est de plus en plus compliqué de se déplacer. J’ai par ailleurs effectué quelques missions à l’étranger, par exemple au Caire ou en Cisjordanie, mais pas dans le cadre de fouilles archéologiques. Mon déplacement actuel en Colombie-Britannique va peut-être créer des opportunités pour mettre mes compétences au service de mes collègues archéologues canadiens.
On a beaucoup entendu parler de vos travaux autour de plusieurs cardiotaphes. Le sujet des funérailles multiples modernes est passionnant. Est-ce qu’il y a une part d’émotion importante lors de l’étude de ces urnes si particulières ?
J’aime à répéter que devant ces vestiges particuliers, l’archéologue est comme un médecin devant un cas compliqué ou un garagiste avec un moteur récalcitrant ! On se focalise sur les aspects techniques : protocoles, enregistrements, photos, données, mais aussi la sécurité des personnes, etc., le tout dans le carcan des questions administratives. La plupart du temps, l’action de fouiller ne peut être mener qu’une fois, il ne faut pas regretter un geste technique ou une approche trop expéditive qui détruirait ou a minima altèrerait un échantillon. D’où, encore une fois, l’importance de la notion d’équipe, où chacun dans son domaine de compétence apporte son expérience. Pour l’étude de ces cardiotaphes, j’ai eu la chance d’être aidé par l’équipe de médecine légale de l’hôpital de Rangueil de Toulouse dirigée par le Professeur Telmon et par le laboratoire AMIS et son directeur le Professeur Crubézy. C’était une belle aventure, scientifique et humaine.

Je suis très intriguée par les retours d’étude autour de ces contenants. La lecture des listes contenant un grand nombre de matières odoriférantes ferait frissonner de nombreux nez. Est-ce que ces éléments sont très perceptibles lors de l’étude ?
Tout à fait, cela fait partie d’un des souvenirs très forts de cette autopsie. Quand nous avons ouvert l’enveloppe en plomb contenant le cœur de Toussaint de Perrien (l’époux de Louise de Quengo), nous avons été immédiatement envahis d’une odeur résineuse et poivrée qui m’a évoqué le parfum si particulier du manche de couteau en genévrier de mon papa. C’était très agréable et très doux ! Les échantillons prélevés ont ensuite été envoyés aux archéobotanistes, qui ont pu confirmer la présence de cette essence parmi les 16 plantes mises en œuvre dans la recette du baume que contenait ce cardiotaphe, identifiées grâce aux grains de pollens et aux graines conservés. De son côté, je sais que Philippe Charlier a déjà utilisé des « nez » de grands parfumeurs pour identifier des odeurs volatiles.
Pour terminer cette interview, je demande à chaque intervenant s’il souhaite faire une petite publicité pour ses travaux ou ouvrage. Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous nous conseiller des ouvrages par exemple qui vous ont plu ou qui vous semblent vraiment pertinents autour du sujet de la mort ?
J’en profite alors pour annoncer la sortie aux Presses Universitaires de Rennes de la publication de Louise de Quengo, une bretonne du XVIIe siècle en Octobre prochain, dirigée en collaboration avec Daniel Pichot et Éric Crubézy et la participation d’une quarantaine d’auteurs. Nous l’avons voulu abondamment illustrée et ouverte à un public curieux.
Parmi mes découvertes de 2021 figure incontestablement Et l’évolution créa la femme (éd. Odile Jacob) de Pascal Picq. Superbe enquête sur le statut des femmes au cours du temps. Moins académique et évoquant plus la mort, je conseille à ceux qui ne l’ont pas encore lu le recueil de Maurice Genevoix, Ceux de 14, absolument bouleversant ; celui de Thomas Mann, La Montagne magique, sur le temps qui passe, est également un ouvrage extraordinaire. Je garde aussi un merveilleux souvenir de Ravage de Barjavel (je devrais le relire mais je ne le retrouve plus dans ma bibliothèque !).

Cette interview s’achève, Rozenn a répondu plusieurs questions qui permettent au grand public de mieux connaître son travail, son parcours et surtout, on a hâte de découvrir la suite de ses travaux ! Merci encore Rozenn et bim pour les médisants des squelettes bretons 😉





