Mots clés : Bruno Boulestin, archéothanatologie, anthropologie, archéologie
Afin de vulgariser la mort et créer une passerelle entre le monde académique et le grand public, je vous propose depuis 2019 des interviews de chercheurs et de personnes travaillant en lien avec ce sujet passionnant. Aujourd’hui, la parole est donnée à Bruno Boulestin qui a eu la gentillesse de répondre à mes diverses questions. Nous allons parler d’archéothanatologie.
Bonjour Bruno, merci d’accepter de répondre à quelques questions pour le lectorat du Bizarreum. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours ?
Bonjour, Juliette, c’est un réel plaisir pour moi d’apporter ma modeste contribution au Bizarreum ! Pour me situer en un mot, je suis anthropologue. Mais pour être plus précis, au départ j’ai une formation en anthropologie biologique — celle qu’autrefois on appelait plus volontiers « physique » —, mais mes recherches portent également sur des questions d’anthropologie sociale. Je considère d’ailleurs qu’il s’agit des deux faces d’une même médaille : je travaille sur les pratiques autour de la mort dans les sociétés du passé, et dans ce cadre certaines des informations que l’on peut tirer de l’étude des restes humains (âge au décès, sexe, pathologies traumatiques, traitements des corps, etc.) servent à comprendre comment fonctionnaient ces sociétés, comment elles étaient organisées. Pour cette raison, j’estime du reste que le sens nord-américain de « anthropologie » est bien plus conforme à ce que je fais : là-bas, l’anthropologie comprend quatre branches, la branche socioculturelle, la branche biologique, l’archéologie et la linguistique, tandis que chez nous ce sont des disciplines distinctes. En réalité, je suis à la fois anthropologue biologique, anthropologue social et archéologue (mais pas linguiste !). Pour en revenir à mon parcours, il est un peu atypique. Je suis tombé dans l’archéologie quand j’étais petit (je participais déjà à des fouilles à 13 ans), mais je suis passé par la médecine, que j’ai exercée pendant plusieurs années. Toutefois, ma thèse de médecine portait déjà sur un sujet anthropologique ! Après elle, j’ai fait une thèse en anthropologie, et enfin j’ai soutenu une habilitation à diriger des recherches dans cette même discipline. Depuis que j’ai arrêté d’exercer la médecine, je suis rattaché au laboratoire PACEA (De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement, Anthropologie) et à l’université de Bordeaux.

Vous avez vu et participé à l’évolution du rapport à la mort et à l’étude de cette dernière dans le cadre archéologique et anthropologique en France. Estimez-vous que nous avons fait de beaux progrès dans ces disciplines ?
Oui, c’est indéniable, et des progrès dans deux directions. D’abord, en ce qui concerne la fouille des sépultures, et plus largement des restes humains. Il faut savoir que jusque vers la fin des années 1970, les anthropologues (physiques) n’allaient pas sur le terrain. Ce sont donc les archéologues qui fouillaient les dépôts humains, plus ou moins consciencieusement : ils s’intéressaient souvent bien moins aux morts qu’aux objets qui les accompagnaient. Il n’était ainsi pas rare que les os contenus dans une tombe finissent en vrac dans un sac, sans avoir été précisément observés. Dès le début des années 1960, la fouille de l’hypogée néolithique des Mournouards, dans la Marne, par le grand préhistorien André Leroi-Gourhan et son équipe, avait montré tout l’intérêt d’une étude minutieuse des sépultures. Mais il a fallu attendre une vingtaine d’années pour que se développe une réelle « anthropologie de terrain », sous l’impulsion notamment d’Henri Duday, et que la fouille des restes humains soit systématiquement réalisée par des personnes formées à l’ostéologie humaine et à faire les observations indispensables à la compréhension du fonctionnement des tombes. Maintenant, c’est devenu habituel, et d’ailleurs cela a abouti à la création d’un véritable corps de spécialistes au sein des structures qui font de l’archéologie préventive, une situation qui place la France en pointe en archéologie funéraire et que nous envient beaucoup d’étrangers : nous avons probablement les meilleures données de terrain au monde dans ce domaine.
Mais les progrès de l’archéologie mortuaire n’ont pas concerné que le terrain et se sont également faits dans une autre direction, celle de l’étude et l’interprétation des pratiques. Là encore, jusque dans les années 1970, les anthropologues s’intéressaient surtout aux aspects biologiques et morphologiques (d’où le terme d’anthropologie physique). Une étude anthropologique consistait avant tout à prendre une foultitude de mesures des os pour essayer de déterminer à quel type, quelle « race » appartenaient les morts retrouvés dans telle ou telle sépulture. Mais en ce qui concernait les pratiques funéraires, l’indifférence était presque totale. Seuls certains archéologues s’intéressaient à ces questions, mais en raisonnant essentiellement à partir des structures et des mobiliers. Au cours de ces quarante dernières années, la situation a totalement changé, et aujourd’hui nous étudions avant tout la façon dont les gens traitaient les défunts en fonction des circonstances, à comment ils géraient les cimetières ou les sépultures, à ce que les morts nous enseignent sur les sociétés des vivants. Une dimension sociale a été apportée à une anthropologie qui était autrefois exclusivement biologique.
On peut donc effectivement dire qu’il y a eu de très beaux progrès. D’ailleurs, c’est à tel point, qu’avec Henri Duday nous avons proposé il y a une vingtaine d’années de créer une nouvelle discipline, que nous avons nommée « archéothanatologie », qui consiste en l’étude de la mort, dans toutes ses dimensions, biologiques et sociales, dans les sociétés anciennes. Ce n’est pas tous les jours que les avancées scientifiques conduisent à la création d’une nouvelle discipline !
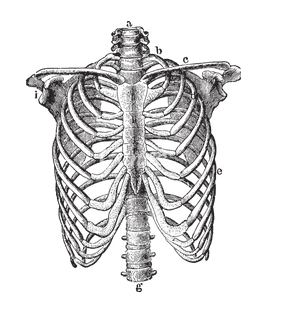
On entend souvent une comparaison entre l’archéologie de la mort chez nous et les pratiques issues du monde anglo-saxon. Que pensez-vous de ce type de comparaisons ?
En ce qui concerne le terrain, comme je viens de l’indiquer, nous sommes clairement en avance sur le monde anglo-saxon, même si la French touch diffuse et que le retard s’amenuise (et c’est tant mieux). En ce qui concerne les interprétations, c’est différent. L’archaeology of death des Anglo-Saxons existe en tant que telle depuis au moins quarante ans, mais en réalité prend ses sources dans les années 1960, avec le courant que l’on nomme l’archéologie des processus, ou en anglais la New Archaeology. Très tôt, ce courant s’est intéressé à l’interprétation sociale des pratiques funéraires, avec des auteurs comme, en particulier, Lewis Binford ou Arthur Saxe. C’est donc nous qui avons dû rattraper notre retard. Dans ses finalités, l’archéothanatologie française ne diffère pas de l’archéologie de la mort anglo-saxonne : comme elle, son objectif ultime est de tirer des informations sur les sociétés à partir de l’étude des pratiques mortuaires. Mais pour y arriver, les deux n’empruntent pas tout à fait le même chemin. L’archaeology of death avait tendance à négliger les morts et s’appuyait essentiellement sur les parures et les mobiliers les accompagnant, et sur l’architecture des tombes. L’archéothanatologie ne néglige pas ces aspects, mais centre son discours sur les défunts eux-mêmes. Pour reprendre une formule employée par H. Duday, elle a remis le mort au centre de la sépulture. Cela rend notre approche des faits mortuaires plus globale. Une autre grande différence est que nous ne nous appuyons pas tout à fait sur les mêmes modèles interprétatifs que les Anglo-Saxons. En effet, pour raisonner sur des sociétés qui n’ont laissé aucun document écrit, aucune iconographie pour nous expliquer ce qu’elles faisaient, il faut bien que nous nous appuyions sur autre chose pour réfléchir, en l’occurrence l’ethnographie et l’anthropologie sociale. Mais nous n’avons pas les mêmes traditions dans ces disciplines de part et d’autre de l’Atlantique, et nous n’utilisons pas les mêmes canevas. Pour ne donner qu’un exemple, les Anglo-Saxons emploient beaucoup les classifications des sociétés proposées par les néo-évolutionnistes américains, alors qu’elles sont très peu utilisées chez nous, et même souvent rejetées. Après, le fait que les approches française et anglo-saxonne soient différentes n’est pas vraiment un problème. Au contraire, leur confrontation peut aider à stimuler la réflexion.
Vous travaillez sur les modifications osseuses visibles sur les défunts. Les personnes ne connaissant pas forcément le sujet ont du mal à se dire qu’il est possible de faire des actes considérés comme violents à nos yeux sur le cadavre (comme une découpe) sans que cela soit lié à une violence en particulier. Est-ce répandu ?
Oui, c’est très répandu : il y a dans le monde de nombreux traitements du cadavre qui paraissent violents, voire outrageants à nos yeux d’Occidentaux, alors qu’ils ne témoignent absolument pas d’un manque de respect envers les morts, bien au contraire. On peut donner l’exemple des funérailles célestes du Tibet, que vous évoquez dans votre livre, mais il y en a bien d’autres, à commencer par le cannibalisme funéraire, qui est souvent perçu comme une pratique abominable. C’est une question fort intéressante, parce qu’elle renvoie à un problème très important, celui de notre vision ethnocentrique. C’est une vision qui a été formatée depuis des millénaires par notre culture et qui nous amène à juger ce qui est différent à l’aune de critères qui nous sont propres, alors que nous devrions au contraire nous affranchir de ces critères, admettre les différences et, surtout, chercher à les comprendre. Ce n’est d’ailleurs pas seulement valable qu’en matière de pratiques funéraires. Il faut souligner que ce biais ne touche pas que le grand public, et que, hélas, beaucoup d’archéologues ont une approche plus ou moins ethnocentrée, ce qui est tout de même embêtant. Mais il est vrai qu’il est très compliqué d’arriver à penser le fonctionnement de sociétés qui nous sont étrangères en se libérant de nos préjugés. Pour illustrer ce problème important, je cite parfois cette histoire que raconte Hérodote : un jour, Darius, le roi de Perse, avait réuni des Grecs et des Calaties (un peuple de l’Inde qui pratiquait le cannibalisme funéraire). Il demanda aux premiers pour quelle somme ils pourraient se résoudre à manger leurs morts, et ils lui répondirent qu’ils ne le feraient jamais, quelle que soit la somme. Ensuite il demanda aux Calaties pour quelle somme ils pourraient brûler leurs morts. Et ils lui répondirent de ne pas tenir un langage si odieux. Je crois que cela montre bien à quel point la perception d’une pratique est liée à la culture de chacun.

Comment vous positionnez-vous face à l’interprétation des différents gestes en contexte funéraire ? Pensez-vous que dans le cadre archéologique pour les sociétés sans écrits nous pouvons être certains d’une hypothèse et d’une conclusion ?
C’est une question importante, mais dont la réponse est complexe. Pour situer la difficulté, il faut déjà comprendre une chose : contrairement à ce qui se passe dans les sciences dites « dures », nous ne pouvons pas directement tester nos hypothèses, nos modèles ou nos théories. Cela rend en particulier compliqué de rejeter ceux qui ne sont pas bons. Dans le langage de Karl Popper, le philosophe des sciences, on dit qu’ils sont non réfutables. Par exemple, on trouve toujours des gens pour prétendre que les pyramides égyptiennes ont été construites par des extra-terrestres. La plupart des personnes estiment l’idée saugrenue, mais dans l’absolu, comment fait-on pour démontrer le contraire ? Sans aller aussi loin, on perd beaucoup d’énergie à essayer de démonter des modèles bancals. Pour revenir à la question, on ne peut jamais être certain d’une hypothèse ou d’une conclusion, et c’est pour quoi dans la très grande majorité des cas la réflexion conduit à en avoir plusieurs, à retenir plusieurs interprétations possibles, sans que l’on puisse décider laquelle est la bonne. On peut juste éventuellement les classer : « cette explication est la plus probable, celle-là la moins probable ». Pour cela, on s’appuie à la fois sur les données archéologiques et sur les données ethnohistoriques. Tout cela étant dit, il faut tout de même bien faire des hypothèses, sinon on n’avancerait pas, car c’est comme cela que la science se construit : avec le temps et les nouvelles recherches, on arrive à éliminer certaines idées et à en retenir d’autres, et petit à petit les conclusions se renforcent. Et puis sinon nous ne serions pas des chercheurs, mais de simples techniciens !
Que pensez-vous de l’apport de l’anthropologie et de l’ethnologie en lien avec l’étude des gestes funéraires du passé ? Quels sont les pièges à éviter selon vous ?
Comme je l’ai souligné plus tôt, pour réfléchir sur des sociétés qui n’ont pas laissé de témoignages autres qu’archéologiques, nous devons nous appuyer sur quelque chose. Autrement, nous n’avons pour seul modèle que les sociétés modernes que nous connaissons, et nous prenons un fort risque de raisonner de façon ethnocentrique. Les références à notre disposition sont les données historiques, ethnographiques et de l’anthropologie sociale. Certains de mes collègues rechignent à les utiliser, mais ils n’ont rien proposé de mieux, et les savants du XIXe siècle procédaient déjà ainsi. En réalité, le problème n’est pas tant de s’en servir que de savoir s’en servir. Le comparatisme ethnohistorique est effectivement un exercice périlleux, et comme tout il s’apprend. Malheureusement, c’est quelque chose qui n’est pas enseigné dans les cursus archéologiques, et pas seulement en France : c’est à chacun de faire l’effort d’apprentissage. Ensuite, si, contrairement à ce que certains pensent, les sociétés ne fonctionnent pas n’importe comment, il n’y a pas de règles simples que l’on peut directement projeter dans le passé. Et rien n’est toujours vrai à 100 %. Mais il y a une différence entre ce qui l’est à 95 % et ce qui l’est à 50 %, et il y a des mécanismes généraux qui régissent le fonctionnement social. Prenons l’exemple des funérailles. L’Homme a pratiquement inventé toutes les manières possibles de traiter ses morts : les brûler, les découper, les fumer, les enterrer, les momifier, les immerger, les mettre à sécher, les donner à manger aux vautours, les manger soi-même, etc., etc. Mais il y a une constante partout et toujours, aussi loin que l’on puisse aller ou remonter dans le temps : les funérailles ont pour but de rendre un dernier hommage au défunt. Dans le même registre, Arnold van Gennep avait montré au début du XIXe siècle que dans une très grande partie des sociétés la mort est un passage, et que les rites pratiqués à l’occasion d’un décès s’inscrivent dans l’ensemble plus grand des « rites de passage » qui partout rythment la vie sociale. En ce qui concerne les pièges à éviter, le principal est celui de l’illustration ethnographique. C’est dire, par exemple : « j’ai découvert une structure qui ressemble à celle qui existe chez tel ou tel peuple d’Afrique, donc elle a le même usage ». Là, on est sûr de se planter. Les comparaisons ethnographiques fournissent un cadre de réflexion, elles n’apportent pas des réponses toutes faites. Comme je le dis souvent, avant tout elles illustrent l’éventail des possibles.

Vous avez travaillé sur le cannibalisme (anthropophagie). On voit de tout et n’importe quoi à ce sujet qui est plutôt complexe. Pour autant, dans l’imaginaire collectif, beaucoup de personnes pensent que cela concerne des peuples considérés comme “exotiques”. Est-ce que nous retrouvons des cas similaires en Europe voire en France ?
Sur le cannibalisme, il a été écrit de quoi remplir une bibliothèque : il fascine autant qu’il répugne. S’il y a une chose à retenir de ce sujet effectivement complexe, c’est que l’on peut en faire une classification simple qui aide à le comprendre. À un premier niveau, il faut distinguer les actes déviants ou circonstanciels des pratiques habituelles. Les actes déviants concernent les tueurs en série, c’est un cas vraiment particulier. Pour le reste, le cannibalisme circonstanciel est celui dit « de famine » ou « de survie » : on mange des morts pour ne pas mourir de faim. On rencontre ce type de cannibalisme toujours et partout, et sans aller chercher très loin l’Histoire de France en fournit de nombreux exemples, jusqu’à une date récente. Et comme la plupart du temps les gens ne se vantent pas d’avoir mangé leur semblable pour survivre, on peut supposer que c’est encore plus fréquent qu’on le pense. Le cannibalisme en tant que pratique, c’est quelque chose de différent : d’une part c’est habituel, d’autre part c’est considéré comme étant normal. Ce cannibalisme, que l’on peut qualifier d’institutionnalisé, se divise lui-même en deux types : l’endocannibalisme, qui consiste à manger les gens de son groupe, et qui est funéraire, et l’exocannibalisme, où l’on mange les gens extérieurs à son groupe, et qui pour l’essentiel est guerrier. Je l’ai évoqué antérieurement à propos de l’histoire rapportée par Hérodote : aussi horrible qu’il puisse nous paraître, l’endocannibalisme est un comportement funéraire comme un autre, qui n’a d’autre but que d’honorer le mort. Et, après tout, y a-t-il une façon d’être plus proche d’un parent décédé que d’avoir un morceau de lui en soi ? Dali disait : « le cannibalisme, c’est le degré suprême de la tendresse » ! Pour l’exocannibalisme, le but est, au contraire, d’anéantir son ennemi, de l’incorporer, de le dominer, d’absorber son énergie… et accessoirement de dissuader les autres. L’endocannibalisme existe encore dans quelques groupes, mais pas en Europe. Quant à l’exocannibalisme, il y en a dans de très nombreuses guerres, y compris modernes, mais on ne peut plus vraiment parler d’actes institutionnalisés, c’est plutôt un épiphénomène. Enfin, en ce qui concerne l’« exotisme », je l’ai également évoqué, c’est une question de perception. Ce que l’on ne comprend pas, ce qui nous effraie, se passe nécessairement ailleurs, très loin, et pas seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Et comme tout le monde le sait, le cannibale c’est toujours l’autre !
Enfin pour terminer, chaque personne interviewée a le champ libre pour recommander des ouvrages (les siens ou autres) en lien avec le sujet. Que recommandez-vous aux lecteurs du site ?
Pour ceux qui voudraient découvrir l’archéologie de la mort, je conseille le petit livre publié aux éditions La Découverte sous la direction de Lola Bonnabel, L’archéologie de la mort en France (2012), dans lequel j’ai d’ailleurs écrit un chapitre. Pour l’anthropologie sociale « préhistorique », les personnes intéressées peuvent commencer par la lecture de l’ouvrage de Christophe Darmangeat Conversation sur la naissance des inégalités (éditions Agone, 2013), avant de se frotter à Avant l’histoire d’Alain Testart (éditions Gallimard, 2012), qui demande un peu plus de connaissances et un certain recul. Sur le cannibalisme, les trois tomes de Sociologie comparée du cannibalisme par Georges Guille-Escuret (PUF, 2010, 2012, 2013) sont une mine incontournable, mais sont très techniques… et, il faut bien le dire, assez difficiles à lire. À réserver aux motivés ! Enfin, deux coups de cœur. Parlant aussi de cannibales, un ouvrage littéraire et non scientifique, L’ancêtre de Juan Jose Saer, merveilleusement traduit par Laure Bataillon : un roman « exotique », philosophique, mais avant tout très beau. Et puis Funèbre !, par l’hôtesse de ce lieu, pour un petit, mais très bel aperçu de la variabilité des pratiques funéraires, qui permet de jeter sur ces dernières un nouveau regard.
Merci à Bruno Boulestin d’avoir accepté cette interview riche en informations sur ce sujet passionnant !




